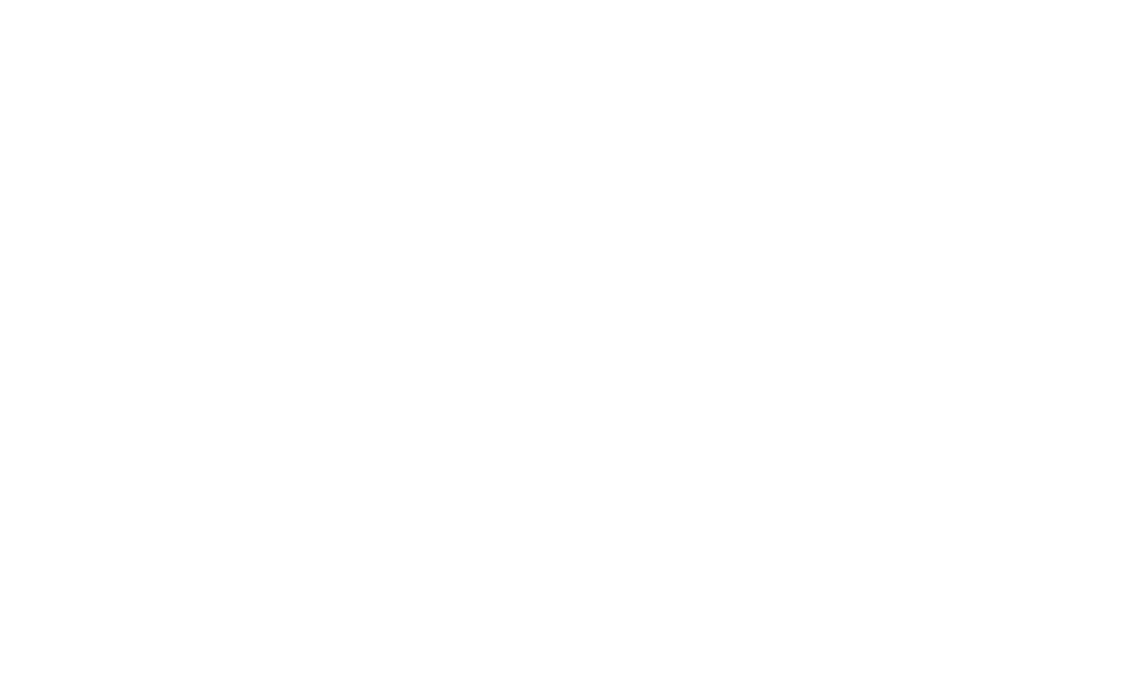Pourquoi est-ce si difficile de faire des prévisions économiques ?
Par Anne de GUIGNÉ
Avis des lecteurs
(cliquez sur leur nom pour accéder à leur site)
Mathématicien, Entrepreneur et Directeur du Master Modélisation et Méthodes Mathématiques en Économie et Finance, Université Panthéon-Sorbonne Paris I
Cet article porte sur la période troublée que traverse la théorie macroéconomique depuis le début du XXIè siècle et sur les conséquences de l’absence actuelle d’une théorie « opérante » concernant notamment la monnaie et l’inflation mais aussi la productivité sur les prévisions macroéconomiques et par conséquent sur les décisions de politique économique.
Les faits sont en effet simples et tristes : la boussole des macroéconomistes – et donc des prévisionnistes – est cassée. Les théories des manuels de macroéconomie n’expliquent plus les liens actuels entre la monnaie et l’inflation. L’innovation, omniprésente, ne se traduit plus en gain de productivité.
Si le constat est connu et intelligemment résumé par l’auteur qui invoque à la fois la sphère académique et les praticiens, il invite à s’interroger selon plusieurs angles :
- Pour un chercheur en économie, cet article invite à voir la période actuelle comme une période nécessitant une révolution scientifique. Pour aller dans le sens de la pensée kuhnienne de la science, nous sommes face à des théories réfutées par les faits mais toujours utilisées en l’absence d’une théorie de remplacement. Quels seront les ingrédients d’une meilleure théorie macroéconomique ? Nous verrons bien.
- Pour le décideur (et peut-être le grand public), cet article invite, même s’il s’agit d’un anachronisme pour un article de 2019, à s’interroger sur les solutions économiques pour amortir la crise liée au coronavirus et relancer l’économie. A l’heure où de nombreuses tribunes appellent à revoir le rôle de la BCE, à financer la dette publique par la planche à billets ou à utiliser de la monnaie hélicoptère pour donner de la trésorerie aux entreprises et/ou aux ménages, cet article nous invite à la modestie en matière de compréhension des effets des politiques budgétaires et monétaires. Il est peut-être temps d’abandonner l’idéologie monétariste et les peurs hyperinflationnistes héritées de la république de Weimar sans retomber dans un keynésianisme béat... bref naviguer à vue en appliquant le principe de précaution et en attendant que les économistes trouvent une théorie opérante comme les médecins un vaccin.
Maître de Conférences en Économie, Sciences Po Grenoble
Anne de GUIGNÉ revient sur les principaux paradoxes de notre époque : l’absence d’inflation, une innovation sans croissance, des cycles pas cycliques et des politiques monétaires et budgétaire inefficaces. L’auteure nous rappelle les fondements des théories économiques en citant les auteurs les plus emblématiques (Friedman et la théorie monétaire, Solow et l’innovation). Aujourd’hui, l’analyse des faits économiques montre que les principaux indicateurs économiques suivent des tendances bien éloignées des lois économiques dominantes comme le montre les infographies et le texte. Cet article réalise une mise au point rigoureuse, et en filigrane il nous rappelle que l’économie et ses indicateurs font partie des sciences économiques, et comme toutes les sciences, celle-ci doit être questionnée et améliorée.
Maître de Conférences en Sciences du Langage, Université de Limoges
La principale vertu des articles sélectionnés dans le cadre du Prix du Meilleur Article Financier est d’opérer une médiation entre l’expert économique et le néophyte dans un but d’accès à la connaissance du domaine économique. Les ajustements terminologiques et apports citationnels témoignent de cette volonté de médiation qui ne prive pas le lecteur d’une réelle démonstration scientifique, appuyée par des données empiriques. Le soin apporté à la didacticité a vocation à modifier l’état de connaissance du lecteur. La fonction informative des articles se double d’une fonction prescriptive invitant à une lecture critique et éclairée du monde contemporain, distanciée des représentations dichotomiques sur l’économie, de ses mécanismes systémiques, et de ses illusoires « mains invisibles ». Quelle que soit la ligne politique adoptée, ces articles constituent de véritables outils démocratiques : s’ils orientent la pensée, ils dotent dans le même temps le citoyen d’un pouvoir analytique, voire se font le relais de cette voix doxique et citoyenne qui appréhende les conséquences directes d’une économie qui interfère autant qu’elle est interférée. Ainsi l’économie est pensée dans ses relations, a priori antagonistes, mais désormais charnelles avec la nature et le vivant. La lecture de ces articles pose en effet une question essentielle pour le devenir de nos sociétés : l’écologie et la santé seront-elles les piliers de l’économie de demain ?
Professeur d’Économie, Directrice du Master Analyse Financière Internationale, NEOMA Business School
L’article d’Anne de Guigné pose des questions fondamentales au bon moment. Il est bien documenté, tout particulièrement sur le plan des références académiques ; ce qui, au demeurant, est normal, puisque l’interrogation de l’auteur a lieu d’être sous un angle théorique. On peut cependant mentionner un manque d’homogénéité quant à la mobilisation des économistes ; cette remarque s’attache à un caractère constructif en ce sens qu’en toute rigueur il conviendrait de donner quelques noms d’économistes en lieu et place de « certains économistes », le lecteur s’attend à savoir qui ils sont sur le sujet évoqué (innovation / gain de productivité / croissance). Globalement l’article est bien écrit, bien argumenté, avec des chiffres à l’appui, donc riche en informations sur un sujet difficile à appréhender pour un non initié. On relèvera l’apport pédagogique de la contribution.